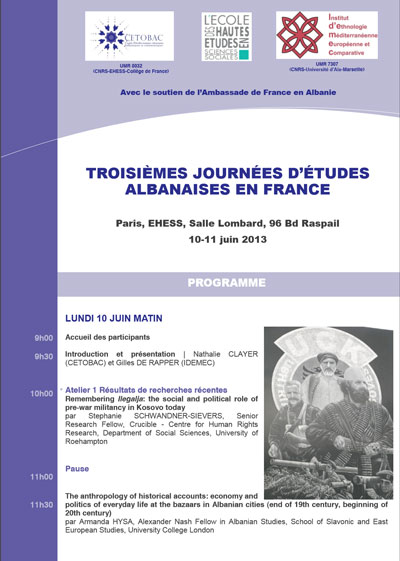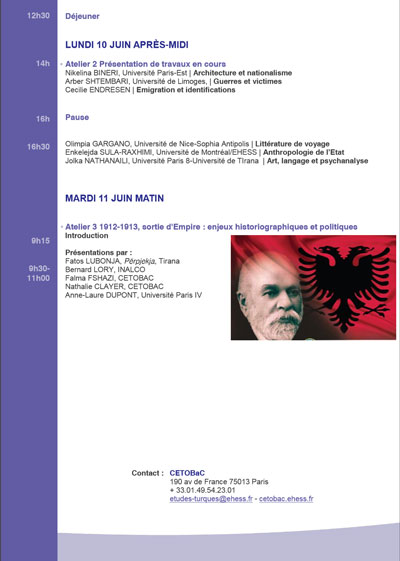Troisièmes journées d’études albanaises en France
10-11 juin 2013
Paris
Compte rendu des travaux
Les troisièmes Journées d’études albanaises en France (JEAF) se sont tenues les 10 et 11 juin 2013 à l’École des hautes études en sciences sociales à l’initiative de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC) et du Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC) et avec le soutien de l’Ambassade de France à Tirana.
Face à la dispersion disciplinaire et géographique des spécialistes de l’Albanie, les JEAF ont pour ambition de réunir les chercheurs menant des travaux sur l’histoire et la société albanaises et d’établir régulièrement un état de lieux de la recherche.
Les travaux ont réuni quatorze participants et se sont déroulés en trois ateliers.
Résultats de recherches récentes
Ce premier atelier invite des auteurs de travaux récents à présenter les résultats de leur recherche sous forme d’une conférence de quarante minutes suivie d’une discussion.
Remembering Ilegalja: the social and political role of pre-war militancy in Kosovo today
Stephanie Schwandner-Sievers, Senior Research Fellow, Crucible – Centre for Human Rights Research, Department of Social Sciences, University of Roehampton
Stephanie Schwandner-Sievers a présenté les résultats d’un projet soutenu par la Fondation Thyssen de 2009 à 2013 portant sur une anthropologie historique du mouvement Ilegalja au Kosovo et qui a donné lieu à l’ouvrage à paraître Militant spirit, the Ilegalja movement in Kosovo. Son exposé s’est appuyé sur une analyse sémantique de termes centraux dans le discours du mouvement sur lui-même, comme ceux de amanet, besa, Kosova, dont elle a montré la signification dans ce contexte. Sur le plan théorique, elle a fait appel à la distinction entre mémoire et héritage (memory, legacy), à la notion de « mémoire culturelle » (Assmann), à celle de familism, qui exprime un passage de la famille à la nation ou au peuple, et aux théories du mouvement social. Son exposé a été l’occasion de revenir sur la périodisation de l’histoire du mouvement Ilegalja et sur sa sociologie.
The anthropology of historical accounts: economy and politics of everyday life at the bazaars in Albanian cities (end of 19th century, beginning of 20th century)
Armanda Hysa, Alexander Nash Fellow in Albanian Studies, School of Slavonic and East European Studies, University College London
Armanda Hysa a présenté sa thèse de doctorat en anthropologie sur les bazars dans les villes albanaises. Elle a rappelé sa formation d’historienne et sa volonté de proposer une histoire sociale différente de l’histoire politique dominante. Son travail ne se veut pas une histoire des artisans et de l’artisanat, mais une anthropologie historique des bazars comme lieux d’échange économique et de sociabilité dans trois villes albanaises : Shkodër, Elbasan et Tirana. Elle s’est appuyée sur des sources qui ne se limitent pas à la statistique : mémoires de consuls, entretiens et témoignages recueillis dans les années 1950 par l’Institut de culture populaire. Interrogeant ces données sous l’angle d’une anthropologie économique (rôle des marchés, conceptions locales des transactions économiques, relation entre culture et économie), elle conclut à la primauté de la fonction économique des marchés sur leur fonction de sociabilité/socialisation. Elle insiste sur leur caractérisation comme nœuds de communication entre le local, le national et l’international et sur l’importance des liens de confiance personnelle dans le fonctionnement des échanges.
Présentation de travaux en cours
Ce deuxième atelier a pour objectif d’offrir un panorama des recherches menées actuellement sous la forme de courts exposés consacrés à différents domaines des études albanaises.
Architecture et nationalisme
Nikelina Bineri (Université Paris-Est) a présenté une recherche sur l’architecture vernaculaire d’origine ottomane dans les Balkans du Sud-Ouest. Elle s’intéresse au devenir de l’architecture utilitaire de la période ottomane à l’époque des nations et des nationalismes, dans quatre régions (Albanie, Macédoine, Bosnie, Kosovo) à travers l’analyse des politiques d’aménagement urbain et de conservation du patrimoine. Son étude de cas principale porte sur la ville de Gjirokastër dans laquelle elle étudie la politique de conservation du patrimoine, de la fin du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Guerres et victimes
Arber Shtembari (Université de Limoges) a présenté son travail de doctorat en cours sur la constitution du statut de victime au Kosovo. À partir d’observations et d’entretiens auprès de quatre associations de victimes (du conflit de 1999 ou de la répression antérieure), il cherche à comprendre les processus de constitution et de reconnaissance de la figure de la victime dans une société post-conflictuelle. Son approche est à la fois cognitive (par l’attention à la mise en récit des événements qui légitiment le statut de victime) et attentive aux relations sociales qui forment le contexte de constitution de l’espace de la victime et permettent de saisir les enjeux et les controverses qui traversent cet espace. Il insiste notamment sur la compétition qui marque les relations entre les différents agents (victimes, responsables d’associations).
Émigration et identifications
Cecilie Endresen (Université d’Oslo) a présenté sa nouvelle recherche sur la place de la religion dans les relations entre Albanais et Grecs dans le contexte de la migration albanaise vers la Grèce. Elle s’interroge sur les conversions des musulmans albanais au christianisme orthodoxe et sur leurs auto-déclarations en tant que Grecs. Son travail s’appuie sur des entretiens menés auprès de jeunes migrants albanais employés dans le secteur touristique, dans les îles. Elle insiste sur la diversité des situations et fait l’hypothèse que l’albanophobie en Grèce est une forme d’islamophobie.
Littérature de voyage
Olimpia Gargano (Université de Nice-Sophia Antipolis et Université de Naples) s’intéresse à trois ouvrages sur l’Albanie écrit dans la même décennie (la première du xxe siècle) par une femme (Edith Durham), un diplomate (Alexandre Degrand) et un Italien (Ugo Ojetti). Elle cherche à comprendre la façon dont se constitue à l’époque en Italie une image de l’Albanie qui rompt avec l’orientalisme pour mettre en avant la proximité et les origines latines ; elle s’interroge sur la présence des femmes dans la littérature de voyage sur les Balkans ; elle propose de mieux considérer la contribution des diplomates français à la connaissance de l’Albanie.
Anthropologie de l’État
Enkelejda Sula-Raxhimi (Université de Montréal et EHESS) a présenté sa recherche sur la gestion des Roms en Albanie et au Kosovo depuis la fin de l’Empire ottoman. Elle s’interroge sur la manière dont la mise à l’écart des populations roms s’est produite et de quelles politiques de gestion et de contrôle elle est l’effet. S’inspirant des travaux de Michel Foucault, elle utilise les concepts de dispositifs, de bureaucratie et de violence ainsi que celui de cultural intimacy (Herzfeld). Elle cherche à comprendre comment une population donnée devient un sujet politique. Son travail s’appuie sur des entretiens auprès des populations roms permettant de reconstituer des histoires de vie, principalement à Tirana, et auprès de fonctionnaires de l’État, en poste pendant le communisme et après. Elle mène aussi une recherche documentaire dans les archives albanaises sur la gestion des populations roms (décisions d’éducation, mesures explicites envers les Roms).
Art, langage et psychanalyse
Jolka Nathanaili (Université Paris 8 et Université de Tirana) a présenté sa recherche de doctorat sur la pratique de l’art dans l’Albanie postcommuniste, menée au département de psychanalyse de Paris 8 et en cotutelle à l’université de Tirana, au département de communication et journalisme. Elle travaille sur la production d’Anri Sala, né en 1974 et vivant en France depuis 1996. À partir de son œuvre Intervista, vidéo dans laquelle l’artiste interroge sa mère devant des enregistrements (muets) de 1977 la montrant comme cadre communiste, elle s’interroge sur le rôle du langage dans le communisme (dans quelle mesure était-il aliéné, quel effet cela avait-il sur les gens ?) et dans l’art contemporain (quel rapport entre le son et l’image ?).
Table ronde : 1912-1913, sortie d’Empire : enjeux historiographiques et politiques
Ce troisième atelier avait pour objectif de replacer le centenaire de l’État albanais et ses célébrations dans un cadre plus large. Il marquait aussi la sortie du numéro 30-31 de la revue Përpjekja, consacré à ce thème.
Fatos Lubonja (Përpjekja) a présenté le sommaire du numéro de Përpjekja, qui entend à la fois restituer la complexité de l’événement que constitue l’indépendance et éclairer le traitement dont il fait l’objet aujourd’hui.
Falma Fshazi (CETOBaC) a proposé une comparaison entre trois célébrations de l’indépendance en 1937, 1962 et 2012, en analysant notamment les ouvrages publiés à ces occasions. Elle a insisté sur les continuités (dans la manière de présenter l’histoire de la nation, dans les grands travaux et les monuments marquant les célébrations) et les discontinuités, notamment dans l’organisation.
Nathalie Clayer (CETOBaC) a proposé un bilan de l’historiographie sur l’indépendance de l’Albanie. Elle a critiqué les visions de l’indépendance comme point final (l’histoire aboutit à l’indépendance) ou comme point de départ (l’histoire de l’Albanie se déploie à partir de l’indépendance, dans tous les domaines). Pour voir les choses autrement, elle propose trois pistes de recherche qui mettent en avant la notion de sortie d’empire et le rôle des acteurs : celle des modes de mobilisation, envisagés dans leurs continuités et leurs ruptures ; celle de l’évolution des espaces sociaux et de la spatialisation des rapports sociaux (passage d’un univers multipolaire à un autre) ; celle enfin de l’évolution des formes de gouvernement et de pouvoir.
Bernard Lory (INALCO) est revenu sur le phénomène de sortie d’empire considéré à l’échelle des Balkans, en présentant une typologie des cas de figure (rattachement à un autre empire, autonomie par rapport à l’empire ottoman, puis indépendance, indépendance pleine et complète) et en rappelant ses moments principaux (1878, 1913, 1919, 1941). On peut trouver aussi des points communs dans les revendications poussant à la sortie d’empire (contre la domination confessionnelle des musulmans, la fiscalité, l’insécurité), dans le ton triomphaliste qui accompagne la sortie d’empire comme dans les déceptions qui la suivent.
Anne-Laure Dupont (Université Paris IV) a proposé un exposé sur la sortie d’empire des provinces arabes de l’Empire ottoman. Cette sortie d’empire correspond à une entrée dans les empires coloniaux. Avant l’émergence d’un nationalisme arabe, elle voit apparaître des revendications « arabistes » sur la place de la langue arabe dans l’empire, mais la rupture avec l’ottomanisme n’intervient que plus tard (Seconde Guerre mondiale). Elle insiste sur la diversité des acteurs, musulmans ou chrétiens, émigrés, étrangers (diplomates, missionnaires) et sur la difficulté à penser la nation en contexte musulman.
http://www.suedosteuropa.uni-graz.at/en/people/gilles-de-rapper